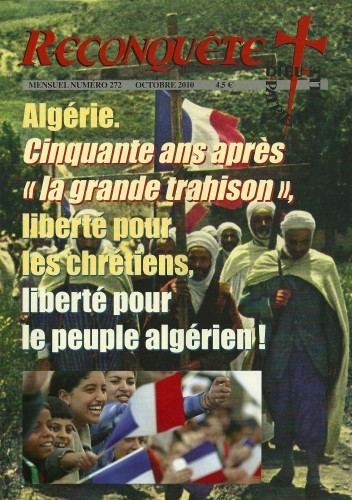
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
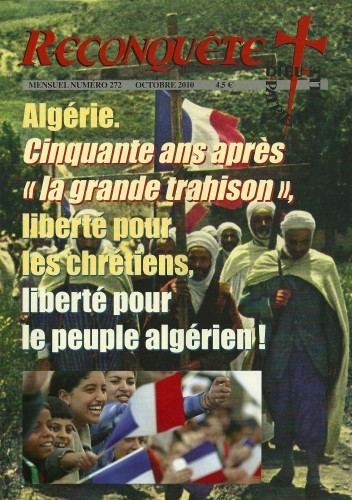
Les manifestations de rue se multiplient pour sauver le système français, moribond, de retraite par répartition. Or, la réalité, occultée par l'Établissement politico-médiatique, est que ce sont les enfants d'aujourd'hui qui paieront les retraites de demain. Face à ce fait, arpenter le pavé parisien pour protester contre le report, sélectif, de l'âge légal de départ à la retraite est aussi utile qu'un cataplasme sur une jambe de bois.
En revanche, demander au Ciel que cesse l'assassinat des enfants à naître est d'une urgente actualité spirituelle, politique et sociale. L'avortement est d'abord un crime contre Dieu –Créateur de toute chose–, il est ensuite, de manière évidente, un crime contre l'enfant conçu, il apparaît enfin, de plus en plus, comme un crime contre l'avenir de la nation.
La seule manifestation utile, le 16 samedi octobre prochain pour la défense des retraites, est la Marche de prière pour la Vie organisée par Renaissance Catholique depuis la basilique de Notre-Dame des Victoires jusqu'à celle du Sacré-Cœur de Montmartre. Comme l'écrivait le cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux, le 19 février 2010 : « Il faut donner leur juste place à ces marches pour la Vie. (…) Nos consciences ont besoin d'être réveillées. Je pense que les différentes marches pour la Vie ont cette fonction. »
Cette Marche de prière publique et de réparation constituera pour tous une excellente préparation aux prières pour la Vie demandées par le pape Benoît XVI, à tous les évêques du monde entier, à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle année liturgique le 27 novembre prochain. À propos de cette démarche Mgr Burke, préfet du Tribunal suprême de la Signature apostolique, n'hésitait pas à déclarer, il y a tout juste une semaine, lors du 5e Congrès mondial de prière pour la Vie, organisé à Rome par l'association Human life international : « C'est un événement très important. Sans précédent dans l'histoire de l'Église. C'est la chose la plus importante et la plus urgente que l'on puisse faire actuellement pour la vie ! Il faut la faire, il faut prier pour la vie, en répondant à l'appel du Pape. »

Ouverte à tous ceux qui œuvrent pour le respect de la vie et de la dignité de la personne, elle est avant tout une marche de prière. Elle s'effectue à un rythme permettant aux enfants d'y participer (5 km). Un cierge et un livret avec prières et chants sont proposés sur place (participation souhaitée de 4 €). Assistance de l'Ordre de Malte tout au long de la marche.
Rendez-vous à 17 h 45 devant la basilique Notre-Dame-des-Victoires, place des Petits-Pères, Paris 2e (M° Bourse) pour la cérémonie de départ. La Marche se termine par un Salut du Saint-Sacrement célébré à 20 h au Sacré-Cœur de Montmartre (M° Anvers).
Nous vous remercions de participer aux importants frais d'organisation (dès 15 €, reçu fiscal possible ; à demander). Chèque à l'ordre de Renaissance Catholique.
Renaissance Catholique 89, rue Pierre-Brossolette 92130 Issy-les-MoulineauxTél. 01 46 62 97 04 - Fax : 01 46 62 95 19 - interro_liens_callback
 Après le succès de l'Agenda Benoît XVI 2010, voici d'ores et déjà, en coédition avec les éditions de l'Oeuvre, l'agenda Benoît XVI 2011.
Après le succès de l'Agenda Benoît XVI 2010, voici d'ores et déjà, en coédition avec les éditions de l'Oeuvre, l'agenda Benoît XVI 2011.
Centré sur le thème de la Vie, de la Civilisation de l'Amour, il apporte un nouveau témoignage et un nouvel éclairage sur la nécessité de suivre le saint Père dans ce combat fondamental pour la Vie.
Renouvelant le partenariat de 2010 avec la Fondation Lejeune, les éditions TerraMare reverseront un euro à la Fondation pour chaque Agenda Benoît XVI 2011 vendu.
Avec une préface exceptionnelle de Son Eminence le Cardinal Philippe Barbarin :
Dans l’encyclique Caritas in Veritate publiée en 2009 et consacrée au « développement humain intégral dans la charité et la vérité », le Pape Benoît XVI écrivait : « Un des aspects les plus évidents du développement contemporain est l’importance du thème du respect de la vie, qui ne peut en aucun cas être disjoint des questions relatives au développement des peuples. » En parcourant les pages de cet Agenda pour l’année 2011, chacun pourra s’imprégner des nombreuses réflexions du Saint Père qui nous sont rapportées à propos de la vie. Puissent-elles soutenir nos engagements et nourrir notre prière. On me permettra de conclure sur ce thème en citant Saint Irénée, le deuxième Evêque de Lyon : « La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant, et la vie de l’homme c’est la vision de Dieu ».
Sommaire
Préface de Son Éminence Philippe Cardinal Barbarin
Janvier 2011 : : Habemus Papam !
Février 2011 : La civilisation de l’Amour
Mars 2011 : Mater Misericordiae
Avril 2011 : Le miracle de la Vie
Mai 2011 : La lumière du monde
Juin 2011 : La vocation, don d’amour
Juillet 2011 : Du sacrement de mariage
Août 2011 : De la fidélité
Septembre 2011 : Heureux les pauvres
Octobre 2011 : Bioéthique et dignité
Novembre 2011 : Vous deviendrez des Saints
Décembre 2011 : Sainte Famille
Béatifications et Canonisations
Direction éditoriale : Grégoire Boucher
Editeurs : TerraMare et les éditions de l'Oeuvre
Date de parution : Septembre 2010
Nombre de pages : 176 pages
Format : 17 cm par 25 cm
Pour commander l'agenda, cliquer sur l'image de couverture

Depuis des siècles, des hommes se sont mis ainsi à l’écoute et à l’école de saint Benoît de Nursie : « Ecoute, ô mon fils, les préceptes du maître et prête l’oreille de ton coeur. » Dès les premiers mots, la Règle de saint Benoît s’appuie sur le dynamisme de l’héritage moral et spirituel, ce que le langage chrétien appelle la piété naturelle. Il faut apprendre et recevoir des Anciens avant que de prétendre s’imposer au monde. Aucune société antique, païenne ou chrétienne, ne fut d’ailleurs bâtie sur une autre vision. Une tournure d’esprit radicalement antimoderne, aux antipodes des conceptions politiques actuelles ou du pédagogisme ambiant. Mais saint Benoît n’entendait pas révolutionner le monde. Au contraire ! Fils d’une bonne famille de la société romaine, il s’en était résolument écarté, décidé à vivre seul avec Dieu. Sa renommée fut telle que le monde le rattrapa pour le porter, presque contre son gré, à la tête d’une communauté religieuse. Son dessein resta pourtant modeste. Il s’agissait de fonder une école « où l’on apprenne le service du Seigneur ». Il posa des fondements aussi simples que son ambition : priorité à la prière, place au travail manuel, humilité et obéissance vécue dans une ambiance familiale où l’abbé tient lieu de père.

Et pourtant ! Des quelques principes transcrits sans apprêt dans la Règle de saint Benoît ont éclos ces monastères et ces abbayes qui ont recouvert l’Europe comme un champ de pâquerettes un matin de printemps. La carte du XIIe siècle, qui indiquerait l’emplacement de ces lieux de prière, grands ou petits, des chemins qui les relient comme un vaste réseau sanguin à l’échelle d’un continent, serait littéralement à couper le souffle. Dom Gérard Calvet qui, à la fin du XXe siècle, sera le fondateur, dans l’ancien Comtat Venaissin, de l’abbaye Sainte-Madeleine du Barroux, sortie tout droit de la terre dans la fidélité aux traditions monastiques et liturgiques, écrira pourtant : « Les moines ont fait l’Europe, mais ils ne l’ont pas fait exprès. Leur aventure est d’abord, sinon exclusivement, une aventure intérieure. »
Non, les moines ne pensèrent pas un seul instant à construire l’Europe. Ils cherchèrent avant tout le royaume de Dieu, mais, par osmose, ils firent naître des moeurs et une culture chrétienne qui, s’inspirant de la règle bénédictine, eurent les mêmes implications d’un bout à l’autre du continent. De ces ateliers où l’on apprenait les vertus communautaires, la paix et l’humilité en même temps que l’amour du travail bien fait, et autour desquels se regroupèrent les laïcs de ce temps, naquit en fait la chrétienté. Le philosophe Gustave Thibon dira de celle-ci qu’elle est « non seulement l’ensemble des peuples où prédomine le christianisme comme l’indique le dictionnaire, mais un tissu social où la religion pénètre jusque dans les derniers replis de la vie temporelle (moeurs, usages, jeux et travaux), une civilisation où le temporel est sans cesse irrigué par l’éternel ». Dans un langage encore plus imagé, Charles Péguy la définira autrement en écrivant que « le spirituel est constamment couché dans le lit de camp du temporel ».
Fruit de ces épousailles fécondes : on estime qu’avant l’ouverture du concile de Constance, en 1415, pas moins de 15 070 abbayes existaient en Europe. En raison de son équilibre, qui évitait les exagérations ascétiques de l’Orient chrétien, et harmonisait la vie de prière et celle du travail, la règle de saint Benoît se répandit très vite en Occident. Le fils de Charlemagne, l’empereur Louis le Pieux, lui donna un coup de pouce en l’imposant à tous les centres spirituels de son empire. L’effet à long terme de ce quasi-monopole bénédictin ? Le cardinal Ratzinger l’a expliqué dans un livre paru avant son élection comme pape sous le nom de… Benoît, et intitulé, précisément, l’Europe de Benoît : « Le monachisme est resté le garant essentiel non seulement de la continuité culturelle, mais encore et surtout des valeurs religieuses et morales fondamentales, des orientations pour la destinée ultime de l’homme ; en tant que force prépolitique et supra politique, le monachisme est devenu source des renaissances nécessaires, qu’il faut sans cesse renouveler. »

A l’époque médiévale, l’un des fleurons de cet éparpillement monastique fut sans aucun doute Cluny, fondé voici 1100 ans et dont le souvenir, inscrit dans la mémoire des moines et des érudits, est célébré cette année. En 910, en effet, Guillaume Ier, duc d’Aquitaine et comte de Mâcon, fit don à l’abbé Bernon, moine de Saint- Martin d’Autun, d’une villa franque qui devait devenir l’un des plus hauts lieux de la chrétienté. Outre le strict respect de la Règle de saint Benoît, la charte de fondation de l’abbaye stipulait que celle-ci ne dépendrait d’aucun seigneur laïc, ni même d’aucun évêque, mais directement du pape. Par une entorse aux coutumes monastiques, Bernon assura la pérennité de son oeuvre : à l’élection habituelle de l’abbé, il préféra choisir son successeur en la personne d’Odon (927-942), qui institua la lignée des quatre grands abbés de Cluny qui se succédèrent à la tête de l’abbaye durant deux siècles. Si l’on excepte le court abbatiat d’Aymard (942-954), les grandes figures de Cluny furent saint Mayeul (954- 994), saint Odilon de Mercoeur (994-1049), saint Hugues de Semur (1049-1109) et le bienheureux Pierre le Vénérable (1122-1156).
Hugues, cependant, mit fin à la cooptation et revint à l’élection de l’abbé. Ce ne fut pas une réussite. Son successeur immédiat, Ponce de Melgueil (1109- 1122), eut maille à partir avec l’autorité pontificale, démissionna, puis tenta de s’emparer par la force de l’abbaye. L’abbatiat du futur Pierre le Vénérable fut plus calme. Il marque pourtant la fin des grands abbés clunisiens. A son apogée, cette vaste famille monastique comptera 10000 moines vivant sous la Regula monachorum et répartis dans 1200 lieux de prière. Aujourd’hui encore, cette histoire religieuse et sociale dépasse de très loin les seules frontières visibles de l’Eglise.
Si le prestige de Cluny découle de sa fidélité à la règle, elle s’incarna également par un immense rayonnement culturel. Sa bibliothèque rassemblait aussi bien des ouvrages patristiques que ceux des auteurs carolingiens, des livres de médecine aussi bien que de musique. L’étude y était aussi à l’honneur, en philosophie et théologie, bien sûr, mais également en droit, illustrant ce lien étroit entre l’art des lettres et la tension eschatologique comme l’a montré ce grand savant bénédictin que fut dom Jean Leclercq dans l’Amour des lettres et le désir de Dieu.

Mais Cluny rayonna encore par l’architecture de son abbatiale, qui connaîtra pas moins de trois phases de constructions et d’agrandissements avant de devenir le plus grand édifice religieux de son époque. Paradoxalement, ce fut aussi l’une des causes de son déclin. Pour y faire face, il avait fallu s’endetter. L’odieux système de la commende (commenda en latin) – développée surtout à partir du XVe siècle, celle-ci consistait à confier l’administration des abbayes à des clercs séculiers ou à des laïcs qui n’étaient pas soumis à la règle –, la Réforme protestante et les guerres de Religion, enfin la Révolution française, ajoutèrent chacun les coups nécessaires à l’effritement puis à l’effondrement du centre clunisien.

Après le déchaînement des passions révolutionnaires qui entraîna la mise au ban de l’Eglise catholique et la disparition des ordres religieux, il faudra attendre 1833 pour voir renaître le monachisme bénédictin. Un jeune prêtre du diocèse du Mans, acquis aux idées ultramontaines contre le gallicanisme, s’enflamma aussi pour l’idéal bénédictin. Il convainquit quelques prêtres amis et racheta un ancien prieuré sur les bords de la Sarthe dont les pierres étaient vendues sans égard aucun pour la richesse architecturale de l’édifice. Ainsi, sous la houlette de dom Prosper Guéranger, reprirent l’aventure bénédictine de Solesmes et les retrouvailles de la France avec la règle de saint Benoît.
En fait, le restaurateur de l’ordre bénédictin renouait avec une histoire aujourd’hui millénaire et que ses fils actuels célèbrent à travers une année jubilaire jusqu’en octobre. C’est en 1010, en effet, qu’un prieuré dépendant de l’abbaye Saint-Pierre de la Couture, au Mans, fut fondé dans le petit hameau de Solesmes. Beaucoup plus modestement que Cluny, il connut à son tour des heures de gloire et de décadence, avant de sombrer sous les coups de boutoir de la Révolution.
Le Solesmes de dom Guéranger fut certes plus modeste que Cluny. Par décision du siège apostolique, il en fut pourtant constitué l’héritier spirituel. Mais le combat du premier abbé de Solesmes en faveur de la liturgie romaine – un combat de plume, mais viril au point qu’on le surnomma « dom Guerroyer » –, et un patient travail sur le chant grégorien, firent de l’abbaye sarthoise un centre mondialement connu. Du vivant même de dom Guéranger, les écrivains les plus illustres vinrent à Solesmes – entre autres, Louis Veuillot et, surtout, Huysmans – et, plus tard, une non-chrétienne comme Simone Weil y suivra la semaine sainte de 1938.

A son tour, Solesmes essaima, en France d’abord, puis à l’étranger. Nouveau paradoxe, les querelles du laïcisme du début du XXe siècle l’y aidèrent fortement. Refusant les diktats de la République française, les moines de la famille solesmienne, conduits par dom Paul Delatte, un abbé doté d’une riche personnalité, préférèrent l’exil à l’abdication de leurs droits. La République finit par se lasser et autorisa les moines à retrouver le sol national. Ils revinrent, non sans laisser, dans le reste de l’Europe, des foyers bénédictins qui perdurent encore aujourd’hui.
Qu’eût été l’Europe sans le monachisme unifié par la règle bénédictine ? Quand l’Empire romain s’écroula, les monastères héritèrent de la tradition de sa culture. « La tradition latine, souligne le grand médiéviste britannique Christopher Dawson (1889-1970), se perpétua dans l’Eglise et les monastères, et comme les barbares eux-mêmes avaient adopté le christianisme, elle ne resta pas le patrimoine exclusif de la population conquise, mais exerça une influence prépondérante sur l’ordre nouveau. »
 Que faisaient-ils donc, ces moines ? Ils priaient, s’instruisaient, développaient un art de vivre en commun qui rejaillit sur le reste de la société quand celle-ci émergea des ténèbres du chaos. Et ils cultivaient la terre ! On aurait tort de réduire cet aspect à une simple nécessité du moment. Par ce biais, les moines gardèrent le contact avec la création et avec ses lois. Ils furent à même ainsi de recueillir le meilleur du paganisme, ce qui en lui était resté conforme aux lois éternelles de la nature, et dans celle-ci, de la nature humaine. Opérant une synthèse entre ce que l’écrivain Jean-Marie Paupert – disparu le 25 juin dernier – baptisa les « mères patries » (Athènes, Rome et Jérusalem), le christianisme monastique transmit une culture et une manière de vivre non sans l’enrichir de sa propre expérience. Par cercles concentriques, autour du monastère s’établit la paix, cette tranquillitas ordinis qui, selon Augustin le Berbère, est sa véritable définition. C’est ainsi qu’ils contribuèrent à leur place, petite minorité de départ, à façonner l’esprit de l’Europe.
Que faisaient-ils donc, ces moines ? Ils priaient, s’instruisaient, développaient un art de vivre en commun qui rejaillit sur le reste de la société quand celle-ci émergea des ténèbres du chaos. Et ils cultivaient la terre ! On aurait tort de réduire cet aspect à une simple nécessité du moment. Par ce biais, les moines gardèrent le contact avec la création et avec ses lois. Ils furent à même ainsi de recueillir le meilleur du paganisme, ce qui en lui était resté conforme aux lois éternelles de la nature, et dans celle-ci, de la nature humaine. Opérant une synthèse entre ce que l’écrivain Jean-Marie Paupert – disparu le 25 juin dernier – baptisa les « mères patries » (Athènes, Rome et Jérusalem), le christianisme monastique transmit une culture et une manière de vivre non sans l’enrichir de sa propre expérience. Par cercles concentriques, autour du monastère s’établit la paix, cette tranquillitas ordinis qui, selon Augustin le Berbère, est sa véritable définition. C’est ainsi qu’ils contribuèrent à leur place, petite minorité de départ, à façonner l’esprit de l’Europe.
On retrouve cette idée de minorité aujourd’hui quand le cardinal Ratzinger, devenu le pape Benoît XVI, appelait les chrétiens à jouer un rôle dans la construction européenne. « Les chrétiens croyants, écrivait-il, devraient se considérer comme constituant une telle minorité active, et contribuer ainsi à ce que l’Europe retrouve le meilleur de son héritage, et se mette ainsi au service de l’humanité entière. »
A quoi servent les moines aujourd’hui ? A rien, répondait récemment en substance dom Philippe Dupont, l’abbé de Solesmes, à la question d’un journaliste. Un bel éloge de la gratuité dans un univers aujourd’hui entièrement colonisé par le marché, et où tout est appréhendé en fonction d’une valeur marchande. Une réponse qui peut être complétée par les propos de Saint-Exupéry dans sa fameuse Lettre au général X : « Ah général, il n’y a qu’un problème, un seul, de par le monde. Rendre aux hommes une signification spirituelle. Des inquiétudes spirituelles. Faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. Si j’avais la foi, il est bien certain que, passée cette époque de “job nécessaire et ingrat”, je ne supporterais plus que Solesmes. On ne peut plus vivre de Frigidaires, de politique, de belote et de mots croisés. » Voilà, peut-être, ce que le monachisme bénédictin peut apporter aujourd’hui encore à une Europe qui a tourné le dos à son héritage spirituel et moral.
Source : Le Spectacle du Monde
 Samedi 16 octobre 2010
Samedi 16 octobre 2010
de la basilique Notre-Dame-des-Victoires au Sacré-Cœur-de-Montmartre.
Rendez-vous à 17h45, place des Petits-Pères, Paris 2e. M° Bourse
Pour en savoir plus, cliquer sur l'image